Quand vos yeux semblent constamment gonflés au réveil, que vos chevilles deviennent épaisses comme des blocs de bois, et que votre urine devient mousseuse comme une bière fraîche, ce n’est pas juste une mauvaise nuit. C’est peut-être votre rein qui crie. Le syndrome néphrotique n’est pas une maladie en soi, mais un signal d’alarme clair : quelque chose se casse dans les filtres de vos reins. Et ce n’est pas une petite fuite. C’est une rupture massive.
Qu’est-ce qui se passe vraiment dans vos reins ?
Vos reins contiennent des milliers de filtres microscopiques appelés glomérules. Chacun est comme une passoire ultra-fine, conçue pour laisser passer l’eau et les déchets, mais bloquer les grosses molécules comme l’albumine - une protéine essentielle qui garde votre sang bien rempli et vos fluides à leur place. Dans le syndrome néphrotique, cette passoire se déchire. Les podocytes, ces cellules spécialisées qui forment la dernière barrière, se détachent ou se déforment. Résultat ? Des quantités énormes de protéines s’échappent dans l’urine - plus de 3,5 grammes par jour chez l’adulte. C’est ce qu’on appelle la protéinurie massive.Cette perte de protéines fait chuter le taux d’albumine dans le sang. Quand ça arrive, votre corps ne peut plus retenir l’eau où elle doit être. Elle s’infiltre dans les tissus. Voilà pourquoi vos chevilles, vos paupières, parfois même votre ventre et vos poumons se gonflent. C’est l’œdème. Et comme votre foie essaie de compenser la perte de protéines, il produit plus de lipides. Vos cholestérol et triglycérides flambent - souvent au-delà de 300 mg/dL. Vous n’avez pas besoin d’être obèse pour avoir un taux de gras dans le sang de diabétique.
Comment sait-on qu’on a un syndrome néphrotique ?
Il n’y a pas de test unique. C’est une combinaison de signes. En pratique, les médecins cherchent trois choses :- Une protéinurie supérieure à 3,5 g par jour (mesurée sur une collecte d’urine de 24 heures)
- Un taux d’albumine sanguine inférieur à 30 g/L
- Des œdèmes visibles, souvent au visage ou aux jambes
Le cholestérol élevé est presque toujours là, mais il n’est pas obligatoire pour le diagnostic. Chez les enfants, on peut aussi utiliser des tests rapides : plus de 40 mg/m²/h d’albumine dans l’urine, ou plus de 50 mg/kg/jour. Un test de bandelette urinaire peut vous dire si vous avez 2+ ou 3+ de protéines - c’est déjà un signal rouge.
La difficulté ? Beaucoup de gens pensent d’abord à une allergie ou à une rétention d’eau passagère. Une étude sur les parents d’enfants atteints montre que 78 % ont été orientés vers un allergologue avant qu’on ne pense à un problème rénal. Le délai moyen entre le premier œdème et le diagnostic est de 7 à 10 jours. Ce n’est pas anodin. Plus on tarde, plus les risques augmentent.
Les causes : ce qui casse les filtres
Le syndrome néphrotique n’a pas une seule cause. Il en a plusieurs - et elles changent complètement selon l’âge.Chez les enfants, c’est presque toujours la même histoire : maladie à changements minimaux. C’est la cause dans 80 à 90 % des cas. Les reins ont l’air normaux sous le microscope, mais les filtres fonctionnent mal. C’est souvent déclenché par une infection virale - un rhume, une gastro. C’est aussi la forme la plus réceptive aux traitements.
Chez les adultes, c’est une autre histoire. Les quatre principales causes sont :
- Focal segmental glomérulosclérose (FSGS) : 40 % des cas. Des parties des glomérules se cicatrisent en cicatrices. C’est souvent plus résistant.
- Néphropathie membraneuse : 30 %. Le filtre s’épaissit comme un film plastique. Parfois lié à des maladies auto-immunes ou à des cancers.
- Diabète : 20 à 30 % chez les plus de 65 ans. Le diabète endommage lentement les reins. C’est la cause la plus fréquente chez les personnes âgées.
- Lupus : 10 à 20 %. Le système immunitaire attaque les reins lui-même.
Il existe aussi des formes rares : la néphrose congénitale finlandaise, due à une mutation du gène NPHS1, se manifeste dans les trois premiers mois de vie avec une protéinurie dépassant 10 g/jour. C’est très grave. Et certains médicaments - comme les anti-inflammatoires ou la pénicillamine - peuvent aussi déclencher le syndrome.

Le piège invisible : les caillots sanguins
Ce n’est pas seulement l’œdème qui fait peur. Le syndrome néphrotique augmente le risque de caillots sanguins de 2 à 4 fois. Pourquoi ? Parce que les protéines qui empêchent la coagulation s’échappent aussi dans l’urine. Quand le taux d’albumine tombe en dessous de 20 g/L, le risque explose. La thrombose de la veine rénale - un caillot dans le rein lui-même - survient chez 10 à 40 % des adultes en phase sévère.Un caillot dans une veine rénale peut provoquer une douleur soudaine au flanc, une chute brutale de la fonction rénale, ou même une perte du rein. C’est une urgence. Les médecins prescrivent souvent des anticoagulants, même sans symptômes, si le taux d’albumine est très bas. Ce n’est pas une option - c’est une nécessité.
Le traitement : de la cortisone aux nouvelles molécules
Le traitement dépend de l’âge et de la cause.Chez les enfants : le premier traitement est toujours la prednisone. On donne 60 mg/m² par jour (jusqu’à 80 mg max) pendant 4 à 6 semaines. 80 à 90 % des enfants entrent en rémission en 4 semaines. Mais attention : 60 à 70 % auront au moins une rechute. Et les rechutes arrivent souvent après un rhume. La clé ? Ne pas arrêter le traitement trop vite. On diminue progressivement sur 2 à 5 mois.
Chez les adultes : la réponse est moins bonne. Seulement 60 à 70 % répondent à la cortisone. Si ça ne marche pas après 16 semaines, on passe à d’autres traitements : les inhibiteurs de la calcineurine (tacrolimus, cyclosporine) ou le rituximab. Le tacrolimus, par exemple, est donné à 0,05-0,1 mg/kg/jour. Il peut coûter entre 1 200 et 2 500 € par mois.
Un nouveau médicament, le sparsentan, vient d’être testé. Dans l’étude PROTECT, il a réduit la protéinurie de 47,6 %, contre seulement 14,7 % avec un médicament classique. Il est déjà approuvé aux États-Unis pour certaines formes de FSGS. En Europe, il est en attente. Ce n’est pas une cure, mais c’est un vrai progrès.
La nutrition : moins de sel, pas plus de protéines
Beaucoup pensent qu’il faut manger plus de protéines pour compenser la perte. C’est une erreur. Manger plus de 1 g de protéines par kg de poids par jour augmente la pression sur les reins et aggrave la fuite. La bonne dose ? 0,8 à 1,0 g/kg/jour. Pour un adulte de 70 kg, c’est 56 à 70 g de protéines par jour - l’équivalent d’un œuf, 100 g de poulet, 100 g de fromage blanc et une poignée de noix.Le vrai coupable, c’est le sel. Réduire la consommation à moins de 2 000 mg par jour (soit environ une cuillère à café) diminue l’œdème de 30 à 50 % en seulement 72 heures. Cela signifie : pas de charcuterie, pas de soupe en poudre, pas de snacks salés, pas de pain industriel. Même les sauces contiennent du sel caché. Lire les étiquettes devient une habitude.
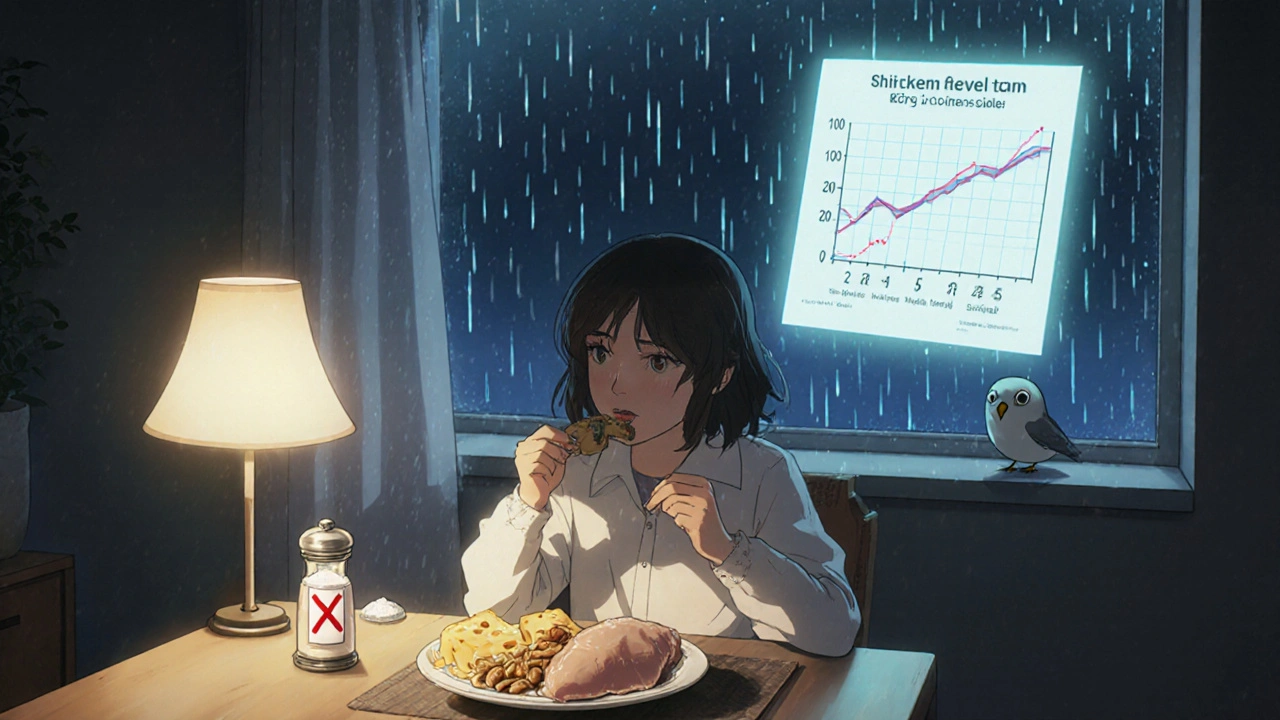
Les suivis et les pièges à éviter
La rémission, c’est quand l’urine ne montre plus de protéines pendant 3 jours consécutifs. La rechute, c’est quand elle revient à 2+ ou 3+ sur bandelette. On teste chaque semaine pendant la phase active.Les vaccins ? À surveiller. Les vaccins vivants - comme ceux contre la rougeole ou la varicelle - sont interdits pendant le traitement à la cortisone. Les vaccins inactivés (grippe, pneumocoque) sont sûrs. Mais on les fait avant de commencer l’immunosuppression, si possible. Le risque d’infection est élevé : les protéines qui combattent les virus partent avec les albumines.
Les effets secondaires de la cortisone sont durs. Chez les enfants, 68 % ont une augmentation de l’appétit - et donc un gain de poids de 10 à 20 %. 55 % développent un « visage de lune » - le visage gonflé. 32 % ont des changements d’humeur, de l’irritabilité, voire des troubles du sommeil. Ce n’est pas « juste » de la prise de poids. C’est un effet médical. Il faut le prévenir, le gérer, et surtout, ne pas l’interpréter comme une faute.
Quel avenir ?
Le pronostic dépend entièrement de la cause. Avec une maladie à changements minimaux, 95 % des enfants ont un rein fonctionnel à 10 ans. Avec le FSGS, c’est 50 à 70 %. Avec le diabète, seulement 40 à 50 %. Et si la protéinurie reste au-dessus de 1 g/jour malgré le traitement, le risque d’insuffisance rénale terminale augmente de 4,2 fois.Les recherches avancent. L’étude NEPTUNE a identifié trois sous-types de FSGS, chacun avec un profil moléculaire différent. Cela veut dire qu’un jour, on pourra dire : « Votre forme répondra à X, pas à Y. » Des molécules qui protègent les podocytes - comme les inhibiteurs de Rho kinase - montrent des résultats prometteurs chez les animaux. Ce ne sont pas encore des traitements, mais c’est la voie.
La FDA a approuvé en 2023 le budesonide (Tarpeyo) pour une forme de maladie rénale liée à l’IgA - et il montre aussi un effet sur certaines formes de FSGS. Ce n’est pas une panacée, mais c’est un début. Le futur du syndrome néphrotique, ce n’est plus la cortisone à tout prix. C’est la médecine personnalisée.
Que faire maintenant ?
Si vous ou un proche avez des œdèmes persistants, une urine mousseuse, et une fatigue inexpliquée : allez voir un médecin. Faites une analyse d’urine. Demandez un dosage d’albumine sanguine. Ne laissez pas passer les signaux. Le syndrome néphrotique n’est pas une phrase mortelle. C’est une alerte. Et une alerte, c’est une chance - de traiter tôt, de sauver les reins, de reprendre la vie.Quelle est la différence entre syndrome néphrotique et syndrome néphritique ?
Le syndrome néphrotique se caractérise par une protéinurie massive (>3,5 g/jour), un œdème sévère et un taux d’albumine bas. Le syndrome néphritique, lui, montre du sang dans l’urine (hématurie), une pression artérielle élevée, et une baisse de la filtration rénale. L’urine du néphritique contient des cylindres de globules rouges, ce qu’on ne voit jamais dans le néphrotique. Ce sont deux pathologies différentes, avec des causes et des traitements distincts.
Le syndrome néphrotique est-il héréditaire ?
La plupart des cas ne sont pas héréditaires. Mais certaines formes rares, comme la néphrose congénitale finlandaise, sont causées par des mutations génétiques (gène NPHS1). Si un enfant développe un syndrome néphrotique avant l’âge d’un an, ou s’il y a un antécédent familial, les médecins recommandent un test génétique. Cela évite des traitements inutiles comme la cortisone ou les immunosuppresseurs.
Est-ce que je peux avoir un enfant si j’ai eu un syndrome néphrotique ?
Oui, mais avec précaution. Si vous êtes en rémission stable depuis au moins un an, et que votre fonction rénale est normale, la grossesse est possible. Mais pendant la grossesse, le risque de rechute augmente. Il faut un suivi étroit avec un néphrologue et un obstétricien. Certains traitements comme les inhibiteurs de l’ACE sont contre-indiqués pendant la grossesse. Il faut adapter le traitement avant de concevoir.
Pourquoi la cortisone fait-elle grossir autant ?
La cortisone modifie la façon dont votre corps utilise les glucides, les lipides et les protéines. Elle augmente l’appétit, fait stocker les graisses au niveau du ventre et du visage, et retient l’eau. Ce n’est pas de la « paresse » ou du manque de volonté - c’est un effet pharmacologique direct. Le gain de poids est souvent de 10 à 20 % du poids initial. Il diminue après l’arrêt du traitement, mais il faut un régime et une activité physique pour le perdre.
Est-ce que je peux guérir complètement du syndrome néphrotique ?
Chez les enfants avec une maladie à changements minimaux, oui - la plupart guérissent définitivement après quelques rechutes. Chez les adultes, la guérison complète est plus rare. La plupart entrent en rémission, mais certains ont des rechutes répétées. Le but n’est pas toujours la guérison, mais la rémission durable. Si vous maintenez une protéinurie inférieure à 0,5 g/jour, votre risque d’insuffisance rénale est très faible. C’est déjà une victoire.







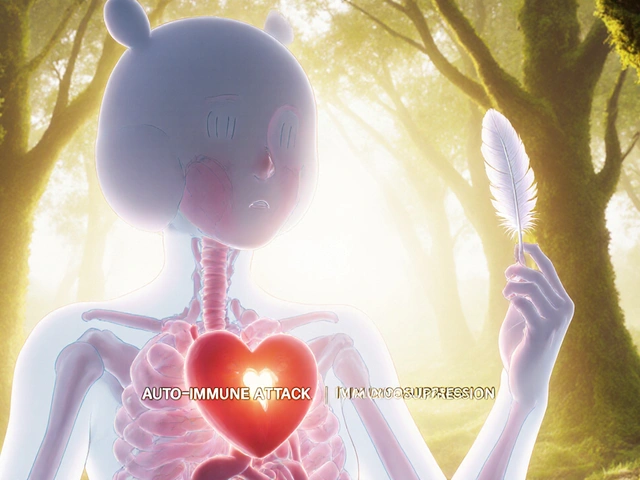
Thomas Sarrasin
Je suis étonné de voir à quel point ce post est précis. J’ai eu un cas chez un patient il y a deux ans, et la confusion avec une allergie a duré trois semaines. On perd du temps précieux quand on ne pense pas aux reins en premier.
La réduction du sel, c’est la première chose qu’on devrait enseigner à tous les patients. Simple, efficace, pas cher.