Le lenalidomide a changé la donne dans le traitement du myélome multiple. Depuis son approbation il y a plus de quinze ans, il a permis à des milliers de patients d’atteindre des rémissions durables. Mais pour beaucoup, cette efficacité ne dure pas. La résistance au lenalidomide devient un mur infranchissable - et c’est là que les choses se compliquent.
Qu’est-ce que la résistance au lenalidomide ?
La résistance au lenalidomide, c’est quand les cellules du myélome multiple cessent de répondre au traitement, même si le patient en a pris pendant des mois ou des années. Ce n’est pas une simple récidive. C’est une transformation biologique. Les cellules cancéreuses changent. Elles activent des voies de survie alternatives, modifient leur environnement, ou même dégradent le médicament avant qu’il n’agisse.
Des études montrent que jusqu’à 40 % des patients développant une récidive après un traitement au lenalidomide présentent une résistance primaire ou acquise. Ce chiffre grimpe à 70 % chez les patients ayant reçu plusieurs lignes de thérapie. Ce n’est pas un échec du patient. C’est un échec du système.
Pourquoi le lenalidomide perd-il son efficacité ?
Le lenalidomide agit en se liant à une protéine appelée CRBN, qui fait partie d’un complexe cellulaire chargé de marquer les protéines indésirables pour destruction. Dans le myélome, il cible deux protéines clés : Ikaros et Aiolos. En les éliminant, il ralentit la croissance des cellules cancéreuses et active le système immunitaire.
Mais les cellules du myélome apprennent. Elles peuvent :
- Modifier le gène CRBN pour que le lenalidomide ne puisse plus s’y attacher
- Diminuer la quantité de CRBN produite
- Activer des voies de signalisation alternatives comme la voie NF-κB ou la voie PI3K/AKT
- Modifier leur microenvironnement osseux pour se protéger des cellules immunitaires
Une étude publiée en 2023 dans Leukemia a montré que les patients avec une mutation du gène CRBN avaient 3,5 fois moins de chances de répondre à une rechute au lenalidomide. Ce n’est pas une coïncidence - c’est une piste clé.
Les nouvelles stratégies pour contourner la résistance
Les chercheurs ne se contentent plus d’augmenter la dose. Ils cherchent à désarmer la résistance à la source. Voici les approches les plus prometteuses en 2025.
1. Les dégradaeurs de protéines de nouvelle génération
Les molécules comme le iberdomide et le cevostamab sont conçues pour cibler CRBN, mais avec une affinité plus forte. Elles fonctionnent même quand le lenalidomide échoue. L’iberdomide, par exemple, active la dégradation d’Ikaros à des concentrations 10 fois plus faibles que le lenalidomide. Dans un essai clinique de phase 3, 52 % des patients résistants ont répondu à l’iberdomide associé à la dexaméthasone - contre 17 % avec le lenalidomide seul.
2. Les thérapies à base d’anticorps bispécifiques
Les anticorps bispécifiques, comme le teclistamab ou le elranatamab, agissent comme des ponts. D’un côté, ils se fixent sur les cellules du myélome. De l’autre, ils recrutent les lymphocytes T du patient pour les détruire. Ces traitements ne dépendent pas de CRBN. Ils contournent complètement la résistance au lenalidomide.
Dans l’essai MajesTEC-1, 63 % des patients résistants au lenalidomide ont vu leur maladie régresser avec teclistamab. Certains sont entrés en rémission profonde, sans chimiothérapie.
3. Les inhibiteurs de la voie BCL-2
Les cellules résistantes au lenalidomide dépendent souvent de la protéine BCL-2 pour survivre. Le venetoclax, un inhibiteur de BCL-2, a montré une efficacité notable chez les patients avec une translocation t(11;14) - une anomalie génétique présente chez 15 à 20 % des patients.
Une étude de l’Institut Gustave Roussy en 2024 a montré que l’association venetoclax + dexaméthasone a induit une réponse objective chez 68 % des patients résistants au lenalidomide et à la bortézomib, avec une durée moyenne de réponse de 14 mois.
4. La thérapie CAR-T : une révolution
Les thérapies CAR-T, comme le idecabtagene vicleucel ou le ciltacabtagene autoleucel, consistent à prélever les lymphocytes T du patient, à les modifier en laboratoire pour qu’ils reconnaissent le myélome, puis à les réinjecter en grand nombre.
Les résultats sont spectaculaires. Dans l’essai CARTITUDE-1, 98 % des patients résistants à trois classes de traitements (incluant lenalidomide) ont répondu à ciltacabtagene. Plus de 70 % étaient en rémission profonde après un an. Ce n’est pas une cure, mais c’est une pause longue, parfois durable.

Comment savoir si vous êtes résistant ?
Il n’y a pas de test unique. Mais voici les signaux d’alerte :
- Une reprise de la douleur osseuse après une période de stabilisation
- Une augmentation du taux de protéine M dans le sang ou dans les urines
- Une baisse du taux de globules rouges ou de plaquettes sans autre explication
- Une progression de la maladie après au moins 6 mois de traitement au lenalidomide
Si vous avez ces signes, une biopsie médullaire et un séquençage génétique sont nécessaires. Ils permettent de détecter les mutations de CRBN, les translocations, ou les anomalies de la voie BCL-2. Ce n’est pas une simple analyse de sang - c’est une analyse de l’ADN de votre cancer.
Quels sont les risques des nouvelles thérapies ?
Les traitements de nouvelle génération sont puissants, mais ils ont des effets secondaires.
Les anticorps bispécifiques peuvent provoquer des syndromes de libération de cytokines (SLC), des réactions immunitaires violentes qui demandent une surveillance hospitalière. Les CAR-T peuvent causer des neurotoxicités ou des cytopenies prolongées. L’iberdomide peut provoquer une fatigue intense ou des troubles digestifs.
Il n’y a pas de traitement sans risque. Mais la question n’est plus : « Est-ce dangereux ? » - c’est : « Est-ce plus dangereux que la progression du myélome ? » Pour beaucoup, la réponse est claire.

Quel avenir pour les patients résistants ?
Il y a cinq ans, un patient résistant au lenalidomide avait peu d’espoir. Aujourd’hui, il a plusieurs options. Le traitement n’est plus linéaire - il est personnalisé. Il dépend de la génétique de la tumeur, de l’âge du patient, de son état général, et de ses priorités.
Les essais cliniques en cours explorent des combinaisons : CAR-T + inhibiteur de BCL-2, bispécifiques + dégradaeurs, ou même des vaccins personnalisés. L’idée n’est plus de tuer le cancer à tout prix - c’est de le contrôler comme une maladie chronique.
Des centres comme l’Institut Curie, l’Hôpital Saint-Louis à Paris, ou le Centre Léon Bérard à Lyon ont déjà intégré ces nouvelles approches dans leurs protocoles. Ce n’est plus de la recherche - c’est de la pratique quotidienne.
Que faire si vous êtes confronté à la résistance ?
Ne perdez pas de temps. Parlez à votre oncologue dès les premiers signes de rechute. Demandez une analyse génétique de votre myélome. Posez des questions sur les essais cliniques disponibles. Ne vous contentez pas d’attendre que le prochain médicament soit approuvé - demandez si vous pouvez y participer maintenant.
La résistance au lenalidomide n’est pas une fin. C’est un point de bascule. Et aujourd’hui, plus que jamais, il y a des chemins pour continuer.
Qu’est-ce qui cause la résistance au lenalidomide dans le myélome multiple ?
La résistance au lenalidomide est principalement causée par des modifications génétiques dans les cellules du myélome, comme des mutations du gène CRBN, une baisse de sa production, ou l’activation de voies de survie alternatives (NF-κB, PI3K/AKT). Ces changements empêchent le médicament de dégrader les protéines Ikaros et Aiolos, qui sont essentielles à son action.
Le lenalidomide peut-il être réutilisé après une résistance ?
Rarement. Si la résistance est due à une mutation de CRBN ou à une perte de son expression, réutiliser le lenalidomide n’a pratiquement aucun effet. Dans certains cas, une pause prolongée suivie d’une réintroduction peut produire une réponse transitoire, mais ce n’est pas une stratégie fiable. Les alternatives ciblées sont bien plus efficaces.
Quels sont les meilleurs traitements après échec du lenalidomide ?
Les options les plus efficaces en 2025 sont les dégradaeurs de protéines comme l’iberdomide, les anticorps bispécifiques (teclistamab, elranatamab), les inhibiteurs de BCL-2 (venetoclax) pour les patients avec t(11;14), et les thérapies CAR-T comme le ciltacabtagene autoleucel. Le choix dépend de la génétique de la tumeur et de l’état du patient.
Les thérapies CAR-T sont-elles accessibles à tous les patients résistants ?
Non. Les CAR-T sont réservées aux patients en bonne condition physique, sans comorbidités majeures, et qui ont échoué à au moins trois lignes de traitement. Le processus est complexe, coûteux, et nécessite un centre spécialisé. Mais les critères s’élargissent progressivement, et des essais visent à les rendre disponibles plus tôt dans le parcours de soins.
Existe-t-il des tests génétiques pour prédire la résistance au lenalidomide ?
Oui. Un séquençage du gène CRBN et une analyse des translocations chromosomiques (notamment t(11;14)) permettent d’identifier les patients à risque de résistance. Ces tests sont désormais recommandés en cas de rechute, surtout avant de changer de traitement. Ils guident le choix entre les thérapies ciblées.




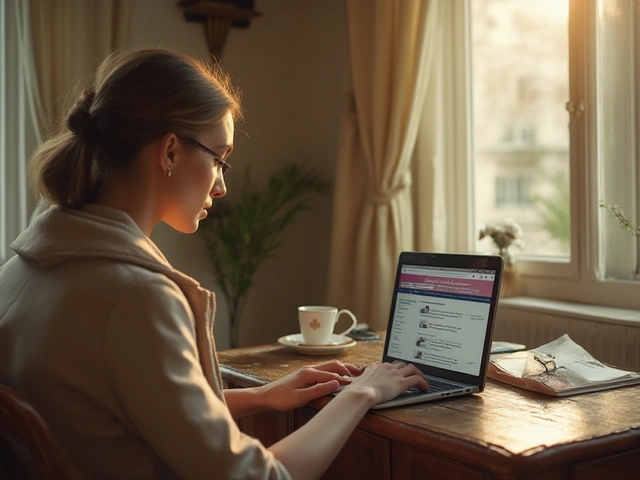


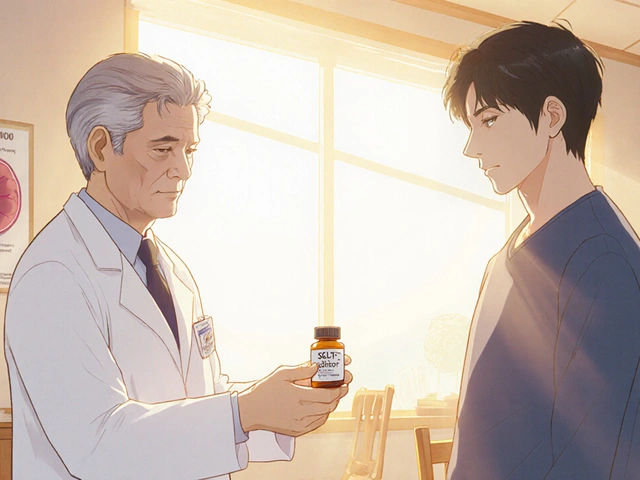
Marie Gunn
Je suis infirmière en oncologie et je vois ça tous les jours. Les patients qui pensaient que le lenalidomide était une solution définitive sont souvent les plus dévastés quand ça arrête de marcher. Mais maintenant, avec les dégradaeurs et les CAR-T, on a vraiment retrouvé un peu d’espoir. C’est pas une cure, mais c’est une vie, après.
Je dis toujours aux familles : ‘C’est pas la fin du chemin, c’est un virage.’