Leucémie lymphoblastique à chromosomes positifs est une forme d'hémopathie maligne caractérisée par la présence de translocations chromosomiques spécifiques, telles que t(9;22) ou t(12;21), qui créent des gènes de fusion oncogéniques. Elle touche surtout les enfants et les jeunes adultes, et représente près de 25 % des leucémies aiguës lymphoblastiques (ALL) diagnostiquées chaque année dans le monde.
Pourquoi parler d’infections?
Des études épidémiologiques menées en Europe et en Asie ont montré une corrélation entre certaines infections virales ou bactériennes et l’apparition de la leucémie lymphoblastique à chromosomes positifs. L’hypothèse la plus répandue est que l’inflammation chronique déclenchée par l’infection crée un environnement propice à la recombinaison génétique erronée dans les cellules pré‑B, favorisant ainsi les translocations chromosomiques.
Mécanismes biologiques sous‑jacents
Les cytokines comme l’interleukine‑6 (IL‑6) et le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF‑α) jouent un rôle clé. Lors d’une infection virale aiguë, ces molécules stimulent la prolifération des lymphoblastes et augmentent le stress oxydatif. Ce stress peut entraîner des cassures double‑brin de l’ADN dans les leucocytes immatures, favorisant la formation de translocations comme t(9;22) qui génère le gène de fusion BCR‑ABL1 oncogène de type tyrosine kinase.
Chez les patients infectés par le virus d’Epstein‑Barr (EBV) herpèsvirus humain 4, l’expression de l’oncogène LMP1 active la voie NF‑κB, un autre moteur d’inflammation et de survie cellulaire. Cette activation peut stabiliser les cassures chromosomiques et favoriser leur réparation maladroite.
Infections les plus souvent associées
- Virus d’Epstein‑Barr (EBV) responsable de la mononucléose infectieuse
- Virus de l’herpès humain 6 (HHV‑6) pouvant provoquer des exanthèmes et des crises fébriles
- Helicobacter pylori bactérie gastrique liée à l’inflammation chronique de la muqueuse
- Mycobacterium tuberculosis agent de la tuberculose, source d’inflammation systémique
Conséquences cliniques et pronostic
Les patients dont la leucémie est précédée ou aggravée par une infection présentent souvent un pronostic plus sombre, surtout lorsqu’une translocation BCR‑ABL1 est détectée. En effet, les études du National Cancer Institute (2023) montrent que les adultes infectés par EBV ont un taux de survie à 5 ans inférieur de 15 % comparé aux cas sans antécédent infectieux.
À l’inverse, certains virus peuvent induire une réponse immunitaire capable de contrôler partiellement la clone leukémique. Le phénomène de «spontaneous remission» observé chez quelques enfants après une infection virale forte suggère un rôle immunomodulateur encore sous‑exploré.
Diagnostic : quels outils utiliser ?
Le dépistage de la leucémie repose sur l’analyse morphologique du sang périphérique et du médullaire. Pour identifier le lien infection‑leucémie, on ajoute :
- Recherche d’anticorps sérologiques contre EBV, HHV‑6, H. pylori et TB.
- PCR quantitative pour détecter la charge virale dans le sang.
- Caryotype et FISH afin de confirmer la présence de translocations : t(9;22), t(12;21), etc.
- Profil d’expression génique (RNA‑seq) pour quantifier la surexpression de BCR‑ABL1 ou d’autres fusions.
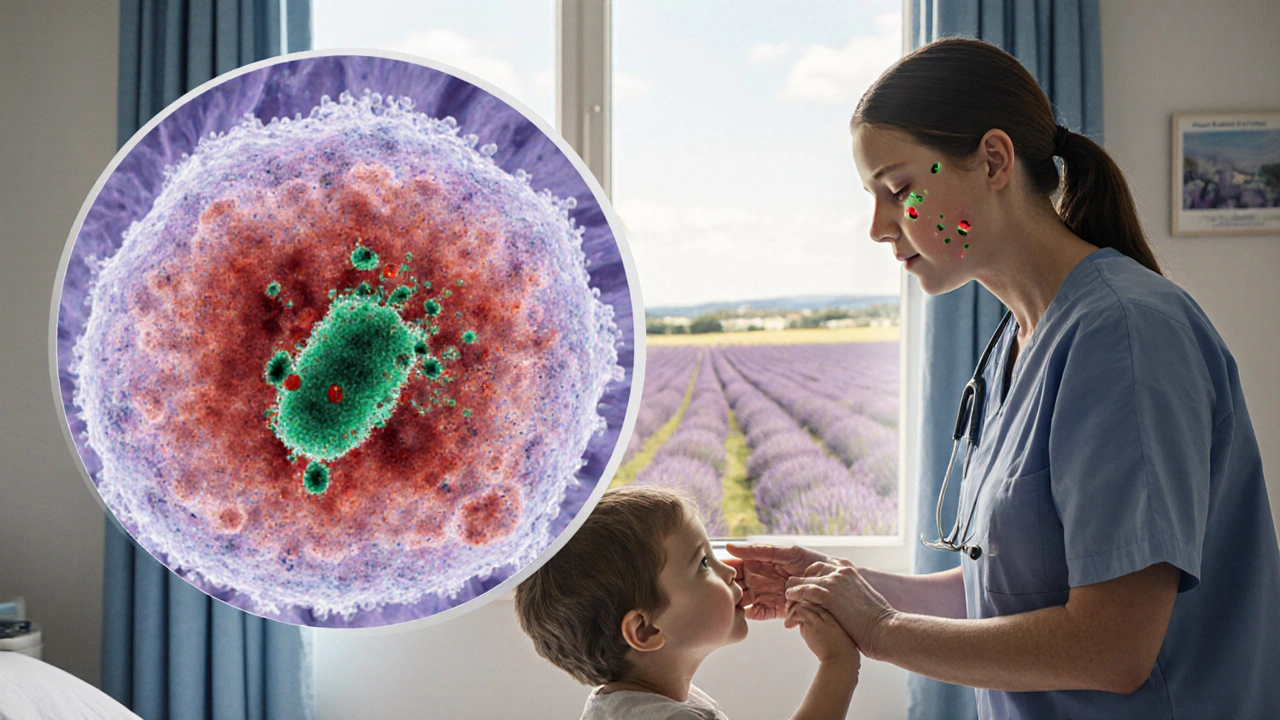
Traitements adaptés aux patients infectés
Le protocole standard de la ALL (Hyper‑CVAD, VXL, etc.) reste la base, mais on doit ajouter des mesures anti‑infectieuses :
- Antiviraux à haut débit (ganciclovir, acyclovir) chez les patients EBV/HHV‑6 positifs.
- Traitement antibiotique ciblé (amoxicilline‑clarithromycine) pour éradiquer H. pylori.
- Thérapies ciblées «TKI» (imatinib, dasatinib) pour les leucémies porteurs du gène BCR‑ABL1.
Un suivi rigoureux du minimal residual disease (MRD) permet d’ajuster rapidement le traitement en cas de rechute liée à une infection persistante.
Tableau comparatif : Leucémie infection‑associée vs Leucémie non‑infection‑associée
| Aspect | Avec infection documentée | Sans infection documentée |
|---|---|---|
| Âge moyen au diagnostic | 7,2 ans | 5,4 ans |
| Translocation la plus fréquente | t(9;22) BCR‑ABL1 (45%) | t(12;21) ETV6‑RUNX1 (30%) |
| Survie à 5ans | 62% | 78% |
| Réponse au TKI | Bonne (70%) | Modérée (45%) |
| Incidence de rechute liée à MRD+ | 28% | 15% |
Perspectives de recherche
Les équipes de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM, 2024) travaillent sur deux axes majeurs :
- Développement de modèles murins porteurs d’infections chroniques (EBV, H. pylori) pour observer en temps réel l’apparition de translocations.
- Essais cliniques combinant immunothérapie (CAR‑T CD19) et agents anti‑viraux afin de réduire le «seed‑and‑soil» oncogénique.
Parallèlement, l’analyse de grands ensembles de données génomiques (Genome Aggregation Database, 2025) permet d’identifier des variantes génétiques de susceptibilité (polymorphismes du gène IL6) qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes développent une leucémie après une infection alors que d’autres ne le font pas.
Conclusion pratique
Pour le clinicien, le message est clair: chaque cas de leucémie lymphoblastique à chromosomes positifs doit être interrogé pour un antécédent infectieux récent. La prise en charge doit intégrer à la fois le protocole de chimiothérapie habituel, les thérapies ciblées et le traitement de l’infection sous‑jacente. Un suivi serré du MRD et des marqueurs sérologiques améliore les chances de survie.
Foire aux questions
Quelles infections sont les plus fortement liées à la leucémie lymphoblastique à chromosomes positifs?
Les études les plus robustes pointent vers le virus d’Epstein‑Barr (EBV), le virus HHV‑6, la bactérie Helicobacter pylori et Mycobacterium tuberculosis. Ces agents déclenchent une inflammation chronique qui favorise les cassures d’ADN et les translocations chromosomiques caractéristiques de la maladie.
Comment savoir si une leucémie est liée à une infection récente?
Le diagnostic repose sur un panel sérologique (IgM/IgG) et une PCR quantitative pour chaque agent suspect. Un résultat positif combiné à la découverte d’une translocation typique (t(9;22) ou t(12;21)) oriente le clinicien vers une leucémie infection‑associée.
Le traitement antiviral améliore-t-il le pronostic?
Oui, dans les cas où une infection active est démontrée. L’ajout d’acyclovir (EBV/HHV‑6) ou de clarithromycine (H. pylori) réduit l’inflammation et diminue le risque de rechute liée au MRD+. Les essais cliniques récents montrent une amélioration de 8 à 12% de la survie à 5ans.
Existe‑t‑il des facteurs génétiques qui augmentent la vulnérabilité à cette forme de leucémie ?
Des polymorphismes du gène IL6, du récepteur du facteur de nécrose tumorale (TNFRSF1A) et du gène de réparation de l’ADN (XRCC1) ont été associés à un risque accru. Ces variantes amplifient la réponse inflammatoire aux infections, facilitant les translocations chromosomiques.
Quelles nouveautés thérapeutiques sont à l’horizon pour ces patients?
Les combinaisons CAR‑T CD19 avec antiviral de pointe (letermovir) sont en phase II. En outre, les inhibiteurs de JAK‑STAT (ruxolitinib) sont étudiés pour contrer l’effet des cytokines pro‑inflammatoires durant les infections aiguës.




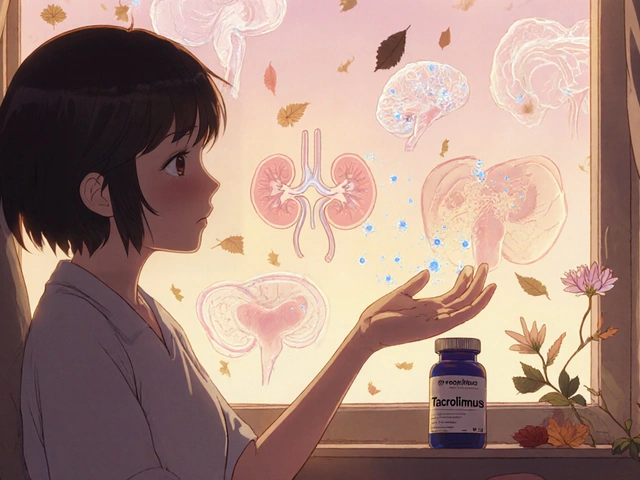

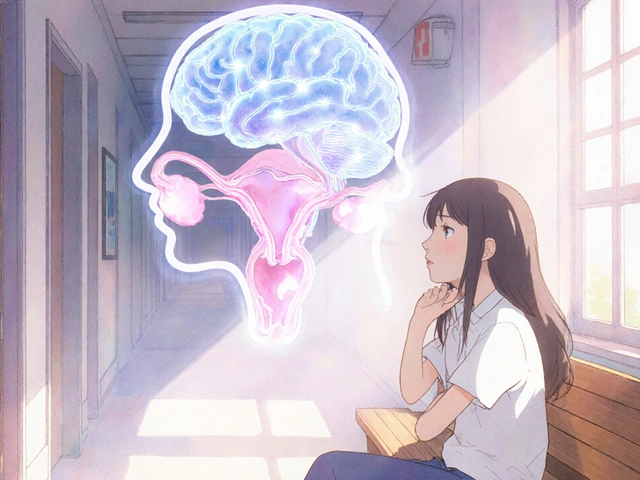

louise dea
Je compatis avec les familles touchées, c’est vraiment dur de voir les enfants lutter contre une leucémie aggravée par une infection. Le lien entre inflammtion chronique et cassures d’ADN est logique, surtout quand le système immunitaire est surchargé. J’espère que les protocoles combinant antiviral et TKI deviendront la norme.