Calculateur de risque de prolongation du QT
Évaluez le risque de prolongation du QT
Résultats de l'évaluation
Risque élevé
La dose d'ondansétro recommandée est trop élevée pour ce patient. Cela pourrait entraîner un intervalle QT > 500 ms, augmentant le risque de torsades de pointes.
Risque modéré
Un intervalle QT potentiellement dangereux (480-500 ms). Vérifiez l'ECG avant l'administration et corrigez les facteurs de risque si possible.
Risque faible
L'interval QT restera probablement en deçà du seuil critique. Cependant, surveillez le patient attentivement.
Recommandations
Quand un antiémétique peut ralentir le cœur
Vous avez peut-être déjà entendu parler de l’ondansétron : ce médicament couramment prescrit pour arrêter les nausées après une chimiothérapie, une chirurgie ou une grossesse. Mais savez-vous qu’il peut, dans certains cas, perturber le rythme électrique du cœur ? L’allongement de l’intervalle QT est un phénomène silencieux, invisible pour le patient, mais potentiellement mortel. Il ne s’agit pas d’un effet secondaire rare : il est bien documenté, mesuré, et surtout, évitable.
En 2012, la FDA a lancé une alerte claire : une dose intraveineuse unique de 32 mg d’ondansétron doit être évitée. Pourquoi ? Parce qu’à cette dose, l’intervalle QT - le temps que le cœur met pour se recharger entre deux battements - peut s’allonger de 20 millisecondes en moyenne. Un écart qui, chez certaines personnes, peut déclencher une arythmie mortelle appelée torsades de pointes. Et pourtant, des années après cette alerte, beaucoup d’hôpitaux continuent d’administrer des doses trop élevées, surtout dans les services d’urgence ou en oncologie.
Comment l’ondansétron affecte le cœur
L’ondansétron ne bloque pas seulement les récepteurs de la sérotonine dans l’estomac. Il agit aussi sur les canaux potassiques hERG dans les cellules cardiaques. Ces canaux permettent au potassium de sortir des cellules après un battement, ce qui permet au cœur de se réinitialiser. Quand ils sont bloqués, le potassium reste piégé, et la phase de repolarisation s’allonge. Résultat : l’intervalle QT sur l’ECG devient plus long.
Des études ont montré que cette prolongation est dose-dépendante. À 8 mg IV, l’augmentation moyenne est de 6 ms. À 16 mg, elle atteint 20 ms. Et à 32 mg - une dose encore utilisée par certains - elle peut dépasser 25 ms. Pour mettre cela en perspective : un allongement de 10 ms augmente le risque d’arythmie de 5 à 7 %. Ce n’est pas une petite chose. C’est une courbe exponentielle de danger.
Le seuil critique est fixé à 450 ms chez les hommes et 470 ms chez les femmes. Un patient avec un QT de 440 ms au repos qui reçoit 8 mg d’ondansétron pourrait facilement atteindre 460-470 ms. S’il a déjà une insuffisance cardiaque, une hypokaliémie, ou prend d’autres médicaments qui prolongent le QT, il entre dans une zone rouge.
Comparaison avec les autres antiémétiques
L’ondansétron n’est pas le seul antiémétique à poser ce risque, mais il est souvent le plus utilisé - et le plus mal compris.
- Dolasetron : plus dangereux encore. La FDA a limité son usage en 2010 à cause de son fort potentiel de torsades de pointes.
- Granisetron : nettement plus sûr. Même en dose IV, son effet sur le QT est 2 à 3 fois moindre que celui de l’ondansétron. La forme transdermique est encore plus douce pour le cœur.
- Palonosetron : aujourd’hui recommandé en première ligne pour les patients à risque cardiaque. Il allonge le QT de seulement 9,2 ms à dose équivalente.
- Droperidol : très efficace, mais il a aussi un risque de QT prolongé. Son usage est restreint, mais il reste un bon substitut dans certains cas.
- Prochlorpérazine : un antipsychotique parfois utilisé pour les nausées. Moins puissant que l’ondansétron sur le QT, mais à éviter chez les patients déjà fragiles.
En 2023, l’American Society of Clinical Oncology a mis à jour ses recommandations : pour les patients avec antécédents cardiaques, la palonosetron est préférée à l’ondansétron. Ce n’est pas une question de prix - c’est une question de sécurité.

Qui est vraiment à risque ?
Le risque n’est pas égal pour tout le monde. Certains patients sont des cibles idéales pour une torsade de pointes :
- Les personnes avec un syndrome du QT long congénital
- Les patients en insuffisance cardiaque
- Ceux avec une fréquence cardiaque lente (bradyarythmies)
- Les personnes ayant un taux de potassium ou de magnésium bas
- Les patients âgés de plus de 75 ans avec plusieurs comorbidités
- Ceux qui prennent déjà un autre médicament qui prolonge le QT : certains antibiotiques (macrolides), antidépresseurs (citalopram), antihistaminiques (hydroxyzine), ou même certains antifongiques
Une étude de Johns Hopkins en 2019 a suivi 15 patients âgés de plus de 75 ans. Trois d’entre eux ont vu leur QT dépasser 500 ms après une simple dose de 8 mg d’ondansétron. Aucun n’avait de problème cardiaque connu avant. Ce n’était pas une coïncidence - c’était un effet cumulatif.
Les bonnes pratiques aujourd’hui
Depuis 2012, les choses ont changé - mais pas assez vite.
En 2022, 92 % des hôpitaux américains avaient mis en place des protocoles pour surveiller l’ondansétron. C’est une avancée majeure. Mais voici ce que ces protocoles incluent vraiment :
- ECG de base : avant toute dose IV, surtout si le patient a un facteur de risque. Pas besoin d’un ECG pour un jeune en bonne santé, mais indispensable pour un patient de 70 ans avec diabète et hypertension.
- Dose maximale de 8 mg IV pour les patients à risque. Même si les recommandations officielles autorisent 16 mg, la plupart des services ont baissé ce seuil à 8 mg pour plus de sécurité.
- Correction des déséquilibres électrolytiques : si le potassium est sous 3,5 mmol/L ou le magnésium sous 1,8 mg/dL, on corrige d’abord. Pas d’ondansétron tant que ces valeurs ne sont pas normales.
- Surveillance post-administration : certains hôpitaux exigent un ECG à 4 heures après l’administration, surtout si le QT initial était supérieur à 440 ms.
- Utilisation de combinaisons : au lieu de pousser la dose d’ondansétron, on ajoute du dexaméthasone. C’est plus efficace, moins risqué, et c’est recommandé par les guidelines du NCCN.
Un hôpital à Boston a réduit les effets indésirables cardiaques de 80 % en passant de l’ondansétron à la palonosetron pour les patients à risque. Le coût a augmenté de 15 %, mais les coûts liés aux complications (réanimation, hospitalisation prolongée) ont chuté de 60 %.
Et si on ne veut pas utiliser d’ondansétron du tout ?
Il existe des alternatives efficaces, surtout pour les nausées liées à la chimiothérapie.
- Aprepitant / fosaprépitant : un antagoniste de la substance P. Très efficace pour les nausées retardées, et sans effet sur le QT. Il est devenu le standard pour les régimes chimiothérapeutiques à haut risque.
- Dexaméthasone : un corticoïde. Moins puissant que l’ondansétron pour les nausées aiguës, mais excellent en combinaison. Dans certains cas, on l’utilise seul pour les patients à haut risque cardiaque.
- Metoclopramide : un prokinétique. Moins efficace pour les nausées sévères, mais sans effet sur le QT. À éviter chez les patients parkinsoniens.
- Chlorpromazine : un antipsychotique. Utilisé dans les cas réfractaires, avec surveillance ECG.
La clé, c’est de ne pas penser en termes de « médicament unique » mais en termes de stratégie. Pour un patient à risque, la combinaison dexaméthasone + palonosetron est souvent plus sûre et aussi efficace que 16 mg d’ondansétron.

Les erreurs courantes dans les services
Malgré les alertes, les erreurs persistent.
La plus fréquente ? Administrer 16 mg IV d’ondansétron à un patient âgé avec une insuffisance rénale. L’ondansétron est éliminé par le foie, mais chez les patients âgés, la clairance est réduite. La dose devrait être abaissée, mais 63 % des infirmières interrogées en 2020 disaient ne pas avoir reçu de formation sur cette adaptation.
Autre erreur : ne pas vérifier les autres médicaments. Un patient qui prend de l’ondansétron et du citalopram (un antidépresseur) multiplie son risque par 3. Pourtant, dans les dossiers médicaux, ces interactions ne sont pas toujours vérifiées.
Et puis il y a la culture du « ça a toujours été comme ça ». Beaucoup de médecins continuent à prescrire 8 mg IV « par habitude », même quand le patient n’a pas de nausées sévères. Une étude a montré que 40 % des doses d’ondansétron administrées en urgence pour des nausées légères étaient inutiles - et potentiellement dangereuses.
Le futur : personnaliser les traitements
La médecine du futur ne se basera plus sur des doses standard. Elle s’adaptera au patient.
Des recherches du NIH (étude QT-EMETIC, NCT04892345) testent actuellement une approche basée sur la génétique. Certains patients ont une mutation du gène CYP2D6 - ils métabolisent mal l’ondansétron. Le médicament reste plus longtemps dans leur sang, et le risque de prolongation du QT augmente. Pour ces personnes, une dose réduite ou un autre antiémétique est la solution.
En 2025, certains hôpitaux commencent à intégrer les tests génétiques dans les protocoles pré-chimiothérapie. Ce n’est pas encore standard, mais c’est l’avenir. Et c’est plus efficace que de surveiller l’ECG à chaque dose.
Conclusion : la sécurité avant la commodité
L’ondansétron reste un excellent antiémétique. Il fonctionne. Il est efficace. Mais il n’est pas sans risque. Et dans la médecine moderne, la meilleure option n’est pas toujours la plus puissante - c’est la plus sûre.
La règle simple à retenir : Ne jamais administrer plus de 8 mg IV d’ondansétron à un patient âgé, cardiaque ou sous d’autres médicaments à risque. Vérifiez l’ECG. Corrigez les électrolytes. Privilégiez les alternatives. Et quand vous avez un doute, demandez-vous : « Est-ce que je fais ça pour le patient, ou pour moi ? »
La nausée se traite. La mort par arythmie, non.
L’ondansétron oral est-il aussi dangereux que l’ondansétron intraveineux ?
Non. La voie orale présente un risque bien plus faible. La FDA a confirmé que des doses orales uniques jusqu’à 24 mg (par exemple pour les nausées liées à la chimiothérapie) ne nécessitent pas d’ajustement. Le risque de prolongation du QT est presque négligeable en voie orale, car l’absorption est plus lente et le pic de concentration dans le sang est plus bas. C’est pourquoi, pour les patients à risque, on privilégie souvent la forme orale quand c’est possible.
Quels sont les signes d’une torsade de pointes ?
La torsade de pointes est une arythmie ventriculaire qui peut apparaître brutalement. Les signes incluent des étourdissements, une perte de conscience soudaine, des palpitations, ou même un arrêt cardiaque. Sur l’ECG, elle se reconnaît par une déformation des complexes QRS qui semblent « tourner » autour de la ligne isoelectrique. C’est une urgence médicale : il faut arrêter le médicament, administrer du sulfate de magnésium, et parfois déclencher une décharge électrique.
Faut-il toujours faire un ECG avant d’administrer de l’ondansétron ?
Pas pour tout le monde. Pour un jeune adulte en bonne santé sans antécédents cardiaques, un ECG n’est pas nécessaire. Mais pour les patients de plus de 65 ans, ceux avec une insuffisance cardiaque, une maladie rénale, un traitement concomitant qui prolonge le QT, ou un taux de potassium bas - oui, un ECG de base est obligatoire. C’est une règle de bon sens, pas une exigence bureaucratique.
Pourquoi la palonosetron est-elle préférée à l’ondansétron chez les patients à risque ?
Parce qu’elle a un effet beaucoup plus faible sur le QT. À dose équivalente, elle allonge l’intervalle QT de seulement 9,2 ms contre 20 ms pour l’ondansétron. Elle agit aussi plus longtemps, ce qui permet une seule injection pour prévenir les nausées aiguës et retardées. Pour les patients déjà fragiles, c’est une alternative plus sûre sans sacrifier l’efficacité.
Que faire si un patient développe un allongement du QT après une dose d’ondansétron ?
Arrêtez immédiatement l’administration. Vérifiez les électrolytes (potassium, magnésium) et corrigez-les. Surveillez l’ECG en continu pendant 4 à 6 heures. Si le QT dépasse 500 ms ou si des signes d’arythmie apparaissent, administrez du sulfate de magnésium IV et préparez-vous à une décharge cardiaque si nécessaire. Informez le cardiologue. Ne réadministrez plus d’ondansétron à ce patient.

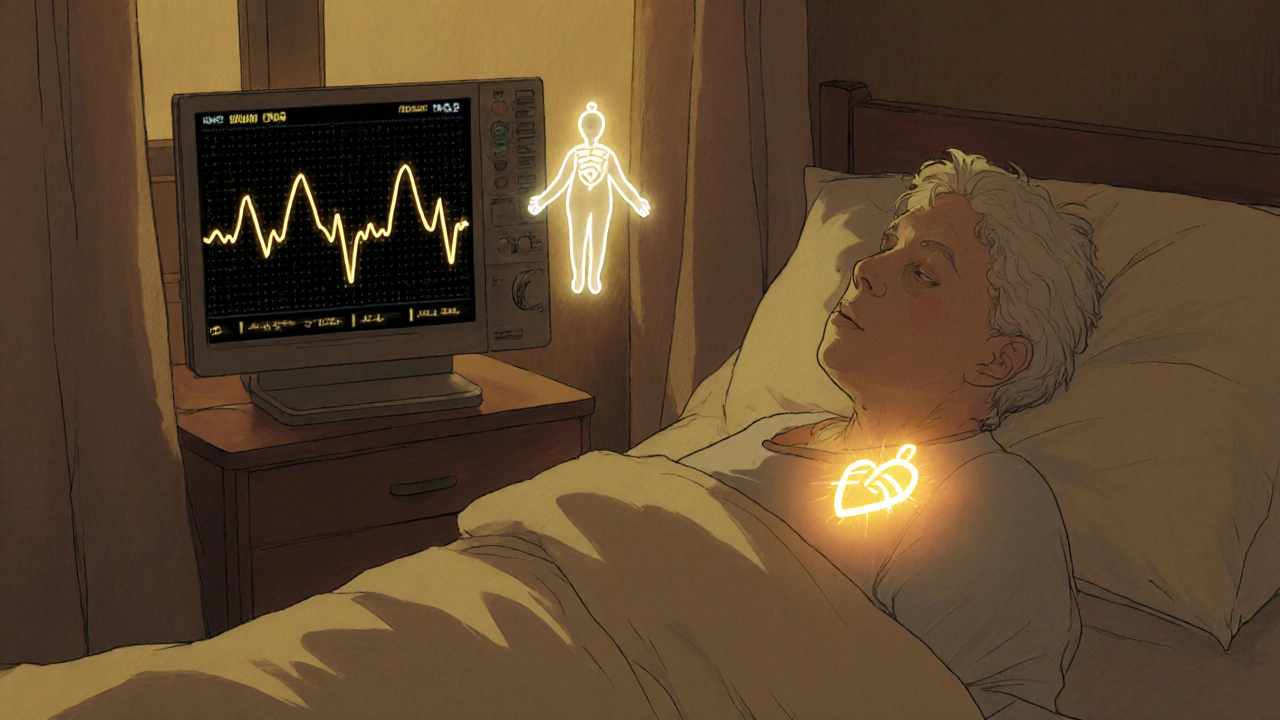

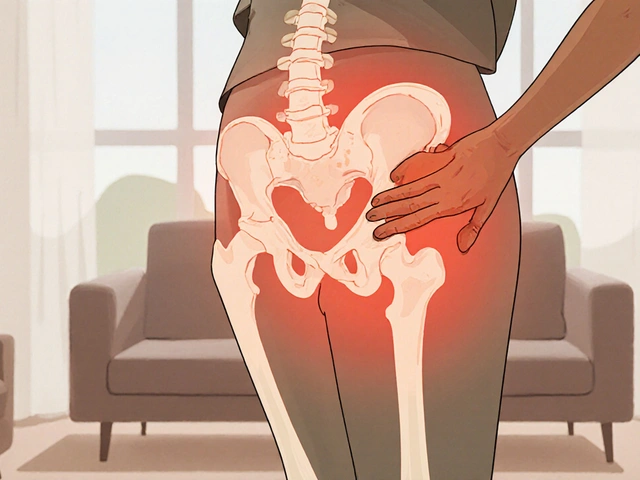

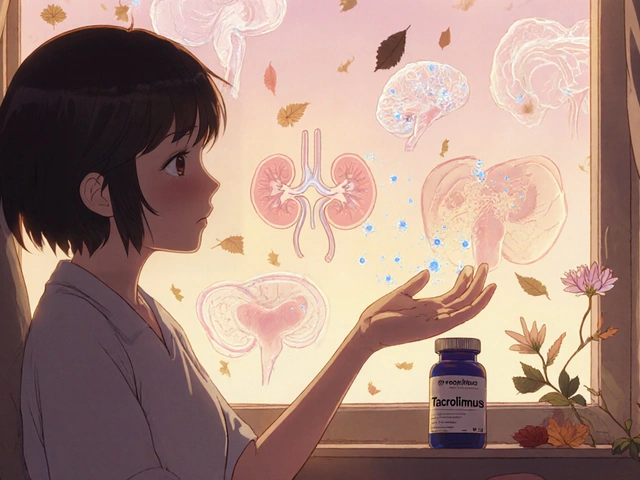
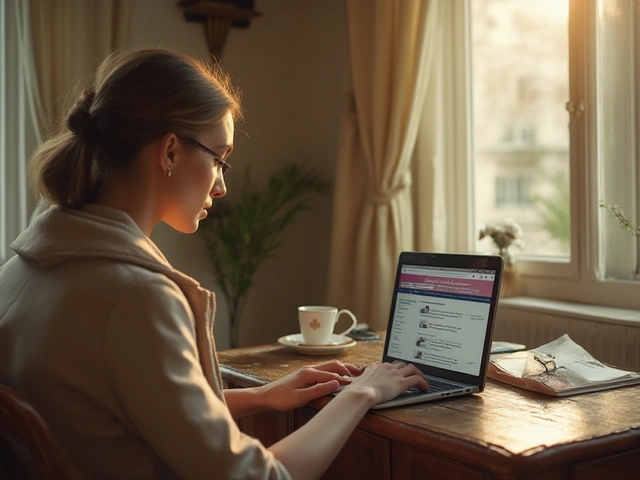

Olivier Rieux
On a vraiment besoin de cette alerte en 2025 ? 😒 L’ondansétron, c’est le placebo du médecin pressé. On injecte 16 mg parce que c’est rapide, pas parce que c’est bon. Et puis on s’étonne que les patients se mettent à déraper cardiaquement... 🤦♂️