Chaque année, des millions de personnes dans le monde prennent des antibiotiques pour une grippe, un rhume ou une otite qui n’a pas besoin d’antibiotiques. Et pourtant, chaque prise inutile augmente le risque que ces médicaments cessent de fonctionner - pas seulement pour vous, mais pour tout le monde.
Quand les antibiotiques deviennent inutiles - et dangereux
Les antibiotiques sont conçus pour tuer les bactéries, pas les virus. Pourtant, dans 30 à 50 % des cas en France et dans d’autres pays développés, ils sont prescrits sans justification réelle. Une toux persistante ? Un nez qui coule ? Un mal de gorge sans fièvre ? Ces symptômes sont souvent causés par des virus. Les antibiotiques ne feront rien. Mais ils feront du mal.
Chaque fois qu’un antibiotique est pris - même à bon escient - il tue certaines bactéries, mais laisse survivre celles qui ont une résistance naturelle. Ces survivantes se multiplient. Au fil du temps, elles deviennent la norme. C’est ce qu’on appelle la résistance aux antibiotiques. Selon l’OMS en 2025, une infection bactérienne sur six dans le monde est déjà résistante aux traitements courants. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter.
Des bactéries comme Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ou Staphylococcus aureus (MRSA) ont développé des résistances massives. Dans certains pays, plus de 40 % des infections urinaires causées par E. coli ne répondent plus aux antibiotiques classiques comme l’ampicilline ou les fluoroquinolones. Dans les hôpitaux, les carbapénèmes - les derniers antibiotiques efficaces contre les bactéries les plus résistantes - commencent eux aussi à échouer.
C. difficile : l’effet secondaire silencieux
Prendre un antibiotique, c’est comme faire une guerre dans votre intestin. Vous tuez les bactéries mauvaises, mais aussi les bonnes. Ces bonnes bactéries, elles, protègent votre système digestif. Elles empêchent les pathogènes comme Clostridioides difficile (C. difficile) de s’installer.
Quand vous éliminez cette flore protectrice, C. difficile - une bactérie présente en faible quantité chez la plupart des gens - peut exploser en population. Elle produit des toxines qui détruisent la muqueuse intestinale. Résultat : diarrhées sévères, douleurs abdominales, fièvre, parfois une colite mortelle.
En 2017, aux États-Unis, C. difficile a causé près de 500 000 infections et 29 000 décès. Même si les chiffres français sont moins précis, les tendances sont les mêmes. En France, les cas liés aux antibiotiques ont augmenté de 25 % entre 2015 et 2023. Et la majorité de ces infections surviennent après un traitement antibiotique, surtout si celui-ci est large spectre (comme la clindamycine, la ciprofloxacine ou les céphalosporines de troisième génération).
Le pire ? C. difficile ne se limite plus aux hôpitaux. On le retrouve de plus en plus chez des personnes en bonne santé, sorties de leur maison après un simple traitement pour une infection dentaire ou une bronchite. Ce n’est plus une infection nosocomiale. C’est une conséquence directe de la surprescription.

Un système qui s’effondre, pas une crise lointaine
Imaginez une chirurgie simple : une appendicectomie, une prothèse de hanche, une chimiothérapie. Tous ces soins dépendent d’antibiotiques pour prévenir les infections. Si ces antibiotiques ne fonctionnent plus, ces opérations deviennent extrêmement risquées.
Des médecins en France et dans le monde rapportent déjà des cas où aucun antibiotique n’agit. Une simple infection urinaire qui se transforme en septicémie. Une plaie opératoire qui ne guérit pas. Un enfant atteint d’une pneumonie qui ne répond à aucun traitement. Ce n’est plus de la science-fiction. C’est la réalité dans certains hôpitaux.
La pandémie de COVID-19 a aggravé la situation. Pendant les pics, les antibiotiques ont été prescrits en masse - souvent sans preuve de bactérie - par peur des complications. Résultat : en 2021-2022, les infections résistantes dans les hôpitaux américains ont augmenté de 20 % par rapport aux années précédentes. En France, les données montrent une hausse similaire des prescriptions d’antibiotiques en ambulatoire pendant cette période.
Qui est responsable ? Et que peut-on faire ?
La surutilisation des antibiotiques n’est pas le fait d’un seul acteur. C’est un système entier qui s’effondre.
Les patients demandent des antibiotiques parce qu’ils croient que c’est la seule solution. Les médecins les prescrivent par peur de se faire reprocher un diagnostic erroné, ou parce qu’ils n’ont pas le temps de faire un test. Les agriculteurs les utilisent massivement pour faire grossir les animaux. Les systèmes de santé manquent de diagnostics rapides pour distinguer les infections bactériennes des virales.
La solution ? Ce n’est pas de ne plus jamais prendre d’antibiotiques. C’est de les prendre quand c’est nécessaire, et exactement comme prescrit.
- Ne demandez pas d’antibiotiques pour une grippe ou un rhume.
- Ne prenez pas les antibiotiques d’un ami ou d’un membre de votre famille.
- Ne stoppez pas un traitement avant la fin, même si vous vous sentez mieux.
- Privilégiez les traitements ciblés. Si un test (comme un prélèvement) peut confirmer une bactérie, attendez les résultats.
- Évitez les antibiotiques à large spectre sauf si c’est absolument nécessaire.
Les hôpitaux doivent aussi faire leur part. Des programmes de stewardship antibiotique - qui encadrent les prescriptions - ont réduit les infections à C. difficile de 30 à 50 % dans les établissements qui les appliquent. En France, ces programmes existent, mais ils sont loin d’être universels.

Et les nouveaux antibiotiques ?
On attend un miracle : un nouveau médicament qui sauvera tout. Mais la recherche peine. Les grandes entreprises pharmaceutiques n’investissent presque plus dans les nouveaux antibiotiques. Pourquoi ? Parce qu’ils sont peu rentables. Un antibiotique est pris pendant 7 à 10 jours. Un traitement contre le diabète ou l’hypertension, pendant des années.
Depuis 2016, CARB-X, un fonds public-privé, a investi plus de 480 millions d’euros dans 118 projets de nouveaux antibiotiques dans 20 pays. Mais sur les 25 antibiotiques jugés essentiels par l’OMS, 12 sont en pénurie dans au moins un pays. Et les nouveaux candidats sont encore loin d’être prêts.
Le vrai remède, ce n’est pas un médicament. C’est un changement de comportement.
Le prix du silence
En 2019, la résistance aux antibiotiques a directement causé 1,27 million de décès dans le monde. Elle a contribué à 4,95 millions d’autres. En 2050, si rien ne change, ce chiffre pourrait atteindre 10 millions par an - plus que le cancer.
Le coût économique ? 100 000 milliards de dollars perdus d’ici 2050. Des millions de personnes qui ne pourront plus subir une chirurgie. Des enfants qui mourront d’une angine. Des grands-parents qui ne survivront pas à une chute.
La résistance aux antibiotiques n’est pas une menace future. Elle est ici. Elle est en train de changer la médecine. Et elle ne s’arrêtera pas tant que nous continuerons à les utiliser comme des bonbons.
La prochaine fois que vous allez chez le médecin pour une infection, posez la question : Est-ce vraiment une bactérie ? Et si la réponse est non, acceptez-le. Votre corps peut se défendre. Et vous sauverez les antibiotiques pour ceux qui en ont vraiment besoin.
Pourquoi les antibiotiques ne fonctionnent-ils plus contre certaines infections ?
Les bactéries évoluent. Quand un antibiotique est utilisé, il tue les bactéries sensibles, mais laisse survivre celles qui ont une mutation naturelle les rendant résistantes. Ces bactéries résistantes se reproduisent et deviennent dominantes. Plus on utilise les antibiotiques - surtout de manière inutile - plus vite cette résistance se propage. C’est une question d’évolution, pas de mauvaise volonté.
C. difficile est-il contagieux ?
Oui. C. difficile se propage par les selles. Les spores de la bactérie peuvent survivre des mois sur les surfaces : poignées de porte, toilettes, vêtements. Elles sont résistantes aux désinfectants classiques. Le lavage des mains avec du savon et de l’eau (pas seulement du gel hydroalcoolique) est essentiel pour les arrêter. Dans les hôpitaux, des protocoles stricts de désinfection sont obligatoires pour les patients infectés.
Peut-on guérir d’une infection à C. difficile sans antibiotiques ?
Oui, dans certains cas légers. Le corps peut rétablir son équilibre intestinal naturellement, surtout si l’antibiotique déclencheur est arrêté. Mais pour les formes sévères, des antibiotiques spécifiques comme la vancomycine ou la fidaxomicine sont nécessaires. Une nouvelle approche prometteuse est la transplantation de flore fécale, qui réintroduit des bactéries saines dans l’intestin. Elle a un taux de succès supérieur à 90 % pour les récidives.
Les antibiotiques d’origine naturelle (plantes, miel, etc.) sont-ils une bonne alternative ?
Certains produits naturels, comme le miel de Manuka ou l’ail, ont des propriétés antibactériennes. Mais ils ne remplacent pas un antibiotique prescrit pour une infection bactérienne grave. Leur concentration est trop faible, leur action trop imprécise. En revanche, ils peuvent être utiles pour les plaies superficielles ou les infections légères, sous surveillance médicale. Ne les utilisez pas comme substitut dans les cas sérieux.
Les antibiotiques utilisés en élevage sont-ils vraiment un problème pour les humains ?
Oui. En France et dans l’UE, l’usage des antibiotiques en agriculture est limité, mais pas éliminé. Les bactéries résistantes peuvent se transmettre aux humains par la viande, le lait, ou même l’eau contaminée. Des souches de E. coli résistantes aux céphalosporines ont été trouvées chez des porcs et ensuite chez des patients humains. La résistance ne connaît pas de frontières. Réduire l’usage vétérinaire est aussi crucial que de mieux prescrire en médecine humaine.







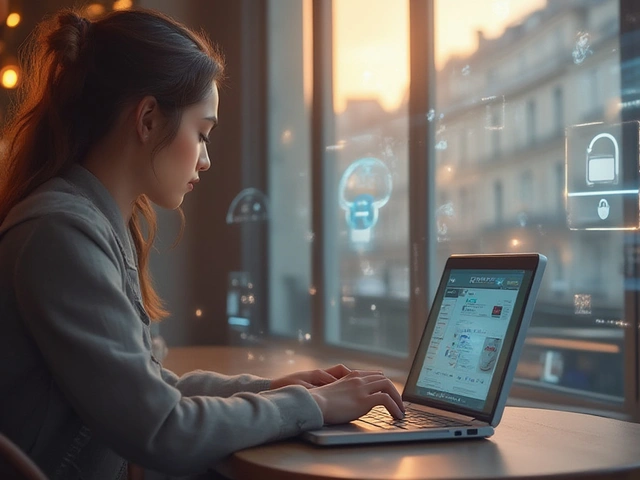
Jean Yves Mea
Chaque fois que je vais chez le médecin pour un mal de gorge, je demande un test rapide. Si c’est viral, je prends du repos, du miel, et je laisse mon corps faire son travail. Les antibiotiques ne sont pas des bonbons, c’est une vérité qu’on a oubliée depuis trop longtemps.
On sauvegarde l’efficacité, ou on se prépare à mourir d’une angine.